 Il y a un peu plus d'un an Leïla me demandait d'écrire un texte pour un livre collectif qu'elle était en train de réaliser...
Il y a un peu plus d'un an Leïla me demandait d'écrire un texte pour un livre collectif qu'elle était en train de réaliser...
Ce livre elle est venue me l'offrir au Salon des Revues au mois d'octobre. Il existe. Il est beau... Les Ed. Bleu autour comme toujours ont valorisé au mieux son travail.
Mais mon texte... celui qui figure dans le livre de Leïla ça n'est pas tout à fait celui que j'avais écrit au départ... Il y avait une contrainte de taille... la taille du texte justement...
Donc il a fallu couper...
Un après-midi Leïla m'appelle :
- Dominique ton texte il est trop long ! Moi je ne veux pas couper alors tu te débrouilles... Tu coupes toi-même et tu me le renvoies... Pas plus d'une page... Tu fais comme tu veux mais pas plus d'une page...
J'ai coupé... Et voici l'original... Je vous l'offre...
Mais que ça ne vous empêche pas d'acheter le livre de Leïla... il est superbe et il a une histoire que je vous raconterai... Une autre fois...
Mektoub sur le ventre des bidons
Jeudi, 27 septembre 2007

- Ecoute… écoute…
- Tu dis quoi ?
- Nous autres on n’a pas d’histoire… on est des gens c’est tout…
Chambre funéraire des Batignolles c’est mardi 11 septembre 2007 y fait beau dessous la voûte rouquine des arbres… Ali l’épicier gentil notre frangin de la cité de La Source à Epinay qui nous largue à notre Mektoub misère… Il se tire pour Alger dans son navire de bois Ali… Ceux qui sont là ils se rappellent p’tits mômes de la zone béton il leur filait des bonbons… Un jour ils ont grandi et Ali écoutait… écoutait leur vie… Heureusement qu’il y a le film Alimentation Générale de Chantal Briet tourné dans la cité qui raconte son histoire…
Ali s’est fait planter par un fou… On est des centaines de gens venus d’Epinay… d’ailleurs… on n’parle pas… le silence nous dégringole dessus comme les marrons minute à minute… Je prends la phrase que répète une vieille dame à sa voisine en pleine tronche…
- Nous autres on n’a pas d’histoire…
Dix ans… ça fait dix ans que j’n’arrête pas de la raconter mon histoire d’Algérie…possédée par elle je suis… possédée dépossédée à fond ! Les Algériens des années 60 les zimmigrés… les zouvriers de Billancourt dos voûtés yeux barrés arrimés là-bas l’ont tracée tatouée avec leurs ongles goudron brûlés à l’intérieur du sable de mon désert d’enfance l’histoire de leur exil…
Mon mektoub d’oasis sur le ventre des bidons… ka ! ta ! ba !… Ka ta ba en arabe… ça veut dire écrire… et ça résonne ! Ça résonne contre ma peau d’enfant d’Aubervilliers tout près du bidonville des Arabes là qu’on habite nous autres en ces années 60…
Bidonville c’est un mot qui nous vient de l’Algérie vous savez ? Alger… pas le port où mon père se pointe 1942 comme ça… et puis direction l’oasis… Biskra… ses palmiers très hauts… Non pas le port mais le ravin quartier du Clos-Salembier… la femme sauvage et le bidonville dans le trou…
Ta ta ta ! sur les tôles ils tapent avec leurs paumes c’est la musique des petits mômes d’Alger nus la peau couleur de dates… c’est la zermi en quadri… Ta ta ta ! Fatima l’amie de Jean Pélégri qui est le scribe des gens et aussi ceux du bidonville elle crèche là…
1962… Le film que tourne Jean avec les gamins arabes espagnols français qui se coursent le long de l’oued dans la plaine de la Mitidja comme sur la photo des trottinettes effacée tachée que m’a donnée Juliette sa femme ce qu’il raconte c’est presque pareil que Cartouches gauloises Juin 2007… c’est l’histoire d’un gosse qui s’appelle Ali…
- Tu dis quoi ?
- Dis quelqu’chose M’sieur Jean… dis quelqu’chose toi qui sais lire…
Fatima… Ouais nous on sait lire on sait écrire… ka ! ta ! ba ! mais la parole des griots qu’est-ce que j’en connais moi ? 1962 la caméra filme Fatima les baraques de la femme sauvage… y a des images y a des mots que je recueille à pleines mains un bout d’années après… 1997… tout ça mêlé à ma mémoire d’enfant des banlieues… la mémoire de ma famille paysanne ouvrière du Nord… les fileteries du Nord vous savez ?
Au-delà des fortifs la zone avec les baraques et les p’tits bouts d’jardins ouvriers c’est là qu’elle s’abrite la galère des damnés de la banlieue années 50 just’après la guerre les taudis des vieux qui ont trop trimé et leurs choses pauvres autour d’eux… photos réchaud bancal casseroles… C’est plein d’enfants crasseux qui courent joyeux dans les chemins creux d’Aubervilliers… “ Gentils enfants d’Aubervilliers… Gentils enfants des prolétaires… Gentils enfants de la misère… ” 1946… Interdites les paroles de Prévert balancées sur les images d’Eli Lotar qui racontent l’histoire des petites gens de la rue ceux qui n’disent rien et qui habitent dans “ la ville sans maisons ”…
- Tu dis quoi ?
- Nous on n’a pas d’histoire…

1956… Ça y est on les a nos quartiers nègres ! A Saint-Denis la Campa est bourrée d’Espagnols chassés par Franco et les Francs-Moisins de Portugais par Salazar … Nous autres les mômes d’Aubervilliers on fonce à la rencontre des Algériens du chemin du halage… Nous autres on crèche dans les premières cités construites rapide bric et broc à côté des baraques et on s’ennuie terrible malgré nos jeux terrains vagues… on est rien qu’entre Gaulois là-d’dans c’est nul !
Alors en bas dans le bidonville des Arabes y a enfin des gens qu’ont une histoire vu qu’ils viennent d’ailleurs… d’un pays du Sud qu’on n’connaît pas… y’a des déserts des caravanes de chameaux de l’or et du sel… y a des rêves plein des outres planquées dans des cavernes précieuses… Les Arabes du bidonville ce sont nos magiciens… ils arrivent ils sont là ! Mektoub … Grâce à eux on entre dans la vie…
La nuit après l’usine qui bouffe les doigts la Renault la Simca le chantier qui leur cimente la gorge mieux que la clope ils parlent… ils racontent là-bas… c’est des mots qu’on n’comprend pas tout… et d’la musique aussi sur un drôle d’instrument… 1966 je frôle les dix piges et mon histoire avec l’Algérie s’écrit là… Ka ta ba ! Sur le ventre des bidons Mektoub !
Mon père nous avait mis au parfum… Il racontait toujours la même d’histoire la sienne… Biskra… l’oasis… l’air bleu qui brûle… les tas de dates les mouches… Et ce pays qui lui a filé entre les mains comme un songe… Qu’est-ce qu’il est venu fiche là ? Sa sueur qui rigole sur sa peau pas rasée… Lui non plus il n’avait pas d’histoire ? Mon père s’est souvenu jusqu’à sa mort de Lakhdar l’Arabe qui ne parlait pas et du chien indigène qui les suivait partout c’était déjà une sorte de conte ?…
Dans le film de Jean 1962 son ami d’enfance Bokhalfa joue son propre rôle le monologue du film c’est la discussion qu’ils ont eue souvent ensemble et les lettres de Bokhalfa il les dictait après lorsque Jean est venu habiter près de la Porte d’Orléans…Je les ai lues… Jean et lui tous les deux derrière la barrière de roseaux de l’oued dans la ferme du kateb… j’imagine… Est-ce qu’il a appris à lire dans l’Algérie indépendante ?…
- Tu dis quoi ?
- Nous M’sieur André on est pas dans la vie…
1963… Jean écrit Le Maboul…
- Moi je ne suis que le kateb… ce sont les gens du petit peuple d’Algérie qui ont écrit ce livre… c’est leur histoire qu’ils m’ont don née… en la notant chaque jour quand Slimane me la racontait à l’oreille j’ai découvert la mienne…
née… en la notant chaque jour quand Slimane me la racontait à l’oreille j’ai découvert la mienne…
1970… Ali Ghalem réalise Mektoub dans le bidonville de Nanterre… J’ai 14 piges et les images de cet immigré algérien qui dort sur des bancs à Paris sur Seine parce qu’à l’hôtel impossible… y’a déjà pas de place pour un faciès… et puis il rejoint ses frangins au bidonville banlieue terre d’asile ? à l’époque c’était vrai peut-être…du boulot y en a pas non plus ou alors n’importe quoi le pire celui que les gens d’ici les Gauloins n’feront jamais… J’ai 14 piges et ces images et ces mots sont ceux qui rebondissent dans mon premier bouquin Par la queue des diables trente ans plus tard…
Ahmed fait une chute de la grue qu’il conduit sur un chantier et à ses amis algériens du bidonville qui viennent pour le voir une dernière fois le contremaître dit sans les regarder :
- Dégagez y’a rien à voir… y’a personne…
- Tu dis quoi ?
- Nous autres on n’a pas d’histoire…
Ahmed et tous les zimmigrés du bidonville de nos enfances… Lakhdar… Jean… Ali… mon histoire d’Algérie possédée dépossédée à fond c’est vous… Moi j’ai une histoire avec de la bonté plein les yeux et un soleil pour signer et c’est tout… Mektoub !

 par la vision du jardin sous la pleine lune. Je n’ai pas fermé les persiennes pour en savourer le spectacle. Les lueurs lactées éclairent la chambre, le lit. Un amandier en fleur juste en face de la baie vitrée semble avoir pillé et cristallisé des gerbes de lumière jetant dans l’ombre le palmier voisin. Son panache forme une nébuleuse éclatante, fourmillant d’incrustations opalines et lilas sur des branches cobalt. Les palmes d’à côté ont l’air de grandes mains suppliciées qui se tendent vers cette splendeur auréolée. ”
par la vision du jardin sous la pleine lune. Je n’ai pas fermé les persiennes pour en savourer le spectacle. Les lueurs lactées éclairent la chambre, le lit. Un amandier en fleur juste en face de la baie vitrée semble avoir pillé et cristallisé des gerbes de lumière jetant dans l’ombre le palmier voisin. Son panache forme une nébuleuse éclatante, fourmillant d’incrustations opalines et lilas sur des branches cobalt. Les palmes d’à côté ont l’air de grandes mains suppliciées qui se tendent vers cette splendeur auréolée. ” 





 e buée d'un bistrot, à vos murmures endormis au creux de vos draps complices des poussières de soleil passant par la fenêtre entrouverte...
e buée d'un bistrot, à vos murmures endormis au creux de vos draps complices des poussières de soleil passant par la fenêtre entrouverte...
 re illustrateur préféré que vous connaissez et on vous invite à faire un détour pour zyeuter ses images vous
en prendrez plein les mirettes ! Alors ne loupez pas cette occase d'être émerveillés c'est pas si courant...
re illustrateur préféré que vous connaissez et on vous invite à faire un détour pour zyeuter ses images vous
en prendrez plein les mirettes ! Alors ne loupez pas cette occase d'être émerveillés c'est pas si courant...




 Un lit comme un livre debout
Un lit comme un livre debout 
 ur les glisser à leur insu entre les fils alignés rigides placés là, immuables rails d’une trajectoire obligée…
ur les glisser à leur insu entre les fils alignés rigides placés là, immuables rails d’une trajectoire obligée… 
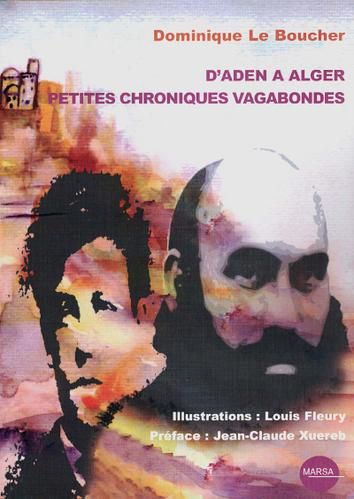 eule approche du sommeil me griffe déjà de son glacial frisson, je veux pouvoir me moquer d’elle, la mort. ( … ) Et, infidèle, je veux m’endormir dans ses bras sur la couche de ma plus belle muse, Poésie. ”
eule approche du sommeil me griffe déjà de son glacial frisson, je veux pouvoir me moquer d’elle, la mort. ( … ) Et, infidèle, je veux m’endormir dans ses bras sur la couche de ma plus belle muse, Poésie. ” Une bonne fin d'année à vous tous et que la vie vous soit douce et bonne... On continue !
Une bonne fin d'année à vous tous et que la vie vous soit douce et bonne... On continue ! Les hommes sans poèmes “
Les hommes sans poèmes “ 
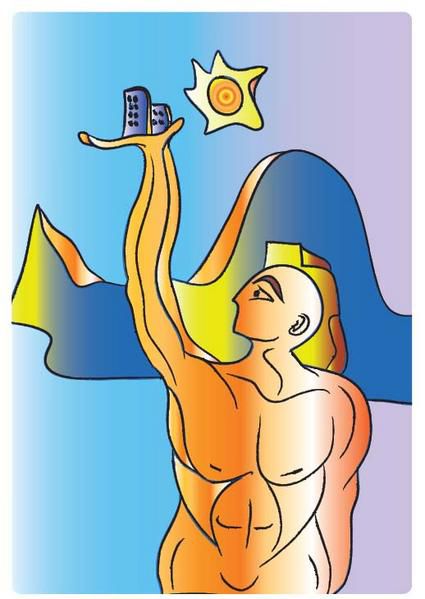

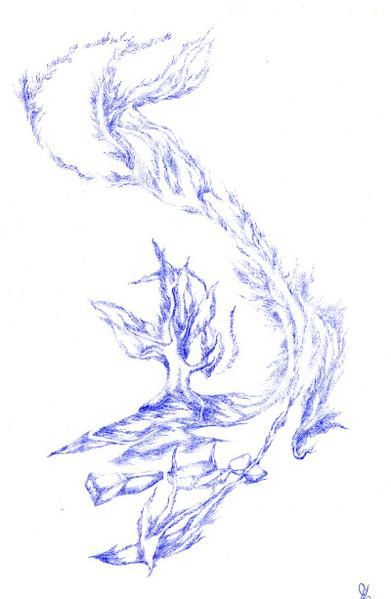






 née… en la notant chaque jour quand Slimane me la racontait à l’oreille j’ai découvert la mienne…
née… en la notant chaque jour quand Slimane me la racontait à l’oreille j’ai découvert la mienne…





