" Pieds nus "
Afin de réaliser un nouveau livre à partir de mes " Chroniques algériennes " qui prendra la suite de celui paru il y a déjà un certain temps intitulé Terre inter-dite je farfouille depuis un moment dans mes pages d'écriture et je suis tombée sur ce premier entretien que j'avais réalisé en 1997 avec Hélène Cixous, quand je l'avais contactée de la part de Leïla Sebbar pour parler de son texte " Pieds nus " qui venait de paraître dans le livre collectif que Leïla avait conçu avec 16 écrivains d'Algérie et qui a pour titre Une enfance algérienne.
C'est drôle car vous pensez peut-être que pour une première rencontre avec Hélène Cixous j'avais une sacrée trouille moi qui ne connaissais rien alors au milieu littéraire ni universitaire eh bien pas du tout... et j'étais allée à ce rendez-vous avec l'écrivaine qu'elle est en toute innocence... Je me souviens lui avoir téléphoné et être tombée sur son répondeur, mon petit message laconique et ma demande alors que je n'écrivais dans Algérie Littérature Action que depuis très peu de temps l'avaient peut-être intriguée... je ne sais pas... Elle m'a rappelée et m'a fixé un rendez-vous un matin vers 8 heures je crois alors que je suis une redoutable couche tard et lève tard ! Très naturellement j'ai hésité à accepter et Hélène m'a répondu d'un ton sans réplique quelque chose comme : " Ah ! non... ne me dites pas ça de cette façon, j'ai décalé tout mon emploi du temps pour vous donner ce rendez-vous ! "
Sa gentillesse et sa disponibilité m'ont paru dès que je l'ai rencontrée et que j'ai réalisé quel être particulièrement entouré et occupé par son écriture ses cours à Saint-Denis le Théâtre du Soleil et tant d'autres choses... extraordianires... Ouais c'est drôle... C'est à cette époque où ma naïveté et mon insouciance me faisaient aborder les écrivaines et écrivains d'Algérie sans hésiter avec naturel et effronterie que j'ai reçu de leur part un accueil enthousiaste et simple... Ensuite dix ans plus tard c'est devenu drôlement compliqué...
Donc je me suis retrouvée un matin dans l'appartement d'Hélène à moitié endormie après trois grands cafés tant je redoutais de ne pas tenir le coup et de somnoler... ç'aurait été gonflé quand même ! Son espace de vie est géant évidemment avec une lumière pas croyable sous le ciel au milieu des arbres c'est très beau... C'est en arrivant dans ce lieu que j'ai seulement commencé à avoir la trouille mais je me souviens qu'elle a parlé tout le temps avec son aisance habituelle et moi je n'avais qu'à m'occuper du dictaphone à la regarder car sa beauté et sa distinction ( celles des êtres qui ont de la grandeur d'âme et de corps c'est rare... ) m'épatait et à poser les quelques questions que j'avais dans la tête...
Je garde un souvenir très vif de cette entrevue qui n'a pas duré plus d'une heure et bien sûr j'ai la cassette dans ma collec perso et je crois bien qu'un de ces jours peut-être pour mon bouquin justement je vais la décrypter à nouveau vu que j'ai dû en laisser tomber une partie j'imagine... à l'époque j'étais un peu une débutante j'ai des excuses... Ce qui me restait en mémoire qui n'apparaît pas dans ce qui suit c'est le passage extra sur le porteur d'eau d'Oran et sur la soif... Des lignes superbes dans son texte que je vais rechercher pour vous les refiler une autre fois car j'avais bien sûr le bouquin d'Une enfance algérienne dédicadé par Leïla dans ma bibliothèque et figurez-vous que je l'ai prêté à Jean-Pierre Lledo quand on a tourné le film documentaire avec Jean Pélégri et il ne m'la jamais rendu !
Me reste plus qu'à aller le racheter c'est pas mal ! Mais j'ai extrait ces quelques lignes de mon entretien car je les trouve toujours aussi passionnantes qu'à l'époque où je les ai retranscrites. J'ai enlevé mes questions pour la plupart sans intérêt... Si je retrouve d'autres choses je vous ferai un autre article pour vous les faire partager...
Pieds nus
Hélène Cixous
Une enfance algérienne
Ed. Gallimard, 1997
“ Oran fut toujours La Ville, la Cité Absolue et sacrée, Ortus, le site aux Signes où Alea le Dieu des hasards de mon histoire m'avait déposée pour naître. ”
Une enfance algérienne “ Pieds nus ”
Hélène Cixous : On connaît explicitement et objectivement encore très peu l'Algérie. A mon avis, on ne peut l'atteindre dans son mystère, puisque c'est l'espace d'une extraordinaire violence ‑ qu'en France on n'imagine jamais que par des moments ‑ des épiphanies. Cet événement que je raconte a choisi sa propre forme pour se dire, comme toujours dans l'écriture. C'est le sujet qui dicte la forme. La forme est intérieure. Dans ce cas, il s'agit d'un souvenir et non d'une fiction.
J'aurais aussi pu appeler ce texte “ une épiphanie algérienne ”. Toute personne ayant vécu en Algérie peut parler de ses parfums. Dire les parfums, c'est dire le visage de l'Algérie. Mais je pense que ce qui me revient à moi, en tant que personne liée d'une manière extrêmement complexe et divisée à l'Algérie, c'est de faire sentir quelque chose qui n'est pas connu. Faire sentir que l'Algérie est à découvrir comme un être sauvage. Il y a de nombreuses histoires comme celle-ci, que j'ai vécues et que j'aurais pu raconter. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'elles faisaient justement partie de moi. Et je n'aurais pas non plus écrit ce texte peu de temps auparavant. J'ai retenu un geste d'écriture au-dessus du corps et de l'âme algérienne, à un moment où je considérais que les Algériens n'avaient pas encore conquis leur totale indépendance d'expression.
J'aurais éprouvé le sentiment d'exploiter quelque chose avec les moyens dont je disposais. Je me serais conduite en colonisatrice après coup, si je m'étais autorisée à utiliser l'énorme trésor algérien. Je me suis mise à écrire ça et là, depuis que les démocrates algériens ont commencé à venir en France pour s'abriter, et depuis qu'eux‑mêmes m'ont parlé et me l'ont demandé.
“ En grimpant j'ôtais mes sandales et je mettais mes pieds dans les mains des morts, et je caressais l'empreinte de leurs pieds avec les paumes de mes pieds. ” “ Pieds nus ”
H. Cixous : J'ai passé toute mon enfance pieds nus. Nous nous racontons souvent, avec mon frère, comment nous faisions des dizaines de kilomètres pieds nus, alors que maintenant cela n'est même plus pensable. Il faut le rappeler justement. Ici, ce n'est pas un signe sociologique ou un signe de pauvreté ‑ ce que c'était aussi parfois ‑ , c'est un rapport, un contact. On touche avec les pieds plus qu'avec les mains. Et on touche ce qu'en général on évite de toucher. Sauf que, lorsqu'on est enfant, on n'a pas peur de marcher dans la poussière et dans la saleté. Donc, on est dans ce rapport de continuité entre la terre qui est tout, et qui, en ce qui concerne la montagne de Santa-Cruz, est aussi pleine de morts puisque c'est un cimetière arabe.
Ma propre légende intérieure a voulu que mon inscription dans cette société se fasse en passant par les morts. Cette inséparation entre les vivants et les morts, que nous éprouvions quand nous montions, était très belle. Et de l'autre côté, il y avait une violence féroce depuis toujours. Ce n'est pas la guerre d'Algérie qui a entraîné cela, je pense que c'est la colonisation. L'Algérie était un pays de sang. On vivait dans les massacres, dans le meurtre et dans la haine, et on faisait semblant de ne pas savoir. C'était une violence intercommunautaire d'un côté et intracommunautaire de l'autre. On se détestait les uns les autres, on se divisait.
A l'intérieur de la communauté juive, il y avait des antagonismes parce que l'on prenait position d'une manière différente sur la colonisation, le racisme et tous ces sujets là. C'était aussi une question de quartier. Moi, j'ai vécu dans des quartiers pauvres, mais, dans des quartiers plus favorisés, on pouvait ne rien voir, puisque l'Algérie était un pays de ghettos. L'intimité familiale était paradisiaque, nous étions des gens très heureux, mais on ne peut pas arrêter sa conscience à cela. Des-cendre dans la rue était une épreuve pour moi. Il fallait voir ce qu'il y avait au coin de la rue, les aveugles, les lépreux, les culs de jatte. Cela grouillait comme en Inde.
Ane et charrette à Gaza en 1993 Photo Marc Fourny
L'étrangeté de la ville, avec son ouverture-coupure sur le port d'où surgissent des êtres délicieux à la limite du réel est un terrain où l'imaginaire trouve sa place à côté du sentiment de culpabilité d'où l'enfant croît sortir lorsque le père est rendu à la pauvreté. Mais la séparation qui a généré le malentendu, prépare déjà l'issue d'un drame où les pieds seront brutalement coupés de la terre d'enfance.
H. Cixous : Oran est un port et j'habitais dans un quartier extraordinairement situé, dans une petite rue malodorante qui descendait jusqu'au quartier de la Marine. De ravissants marins qu'on ne voit plus, et qui étaient certainement ceux que Jean Genet a dû adorer, en sortaient. Ils étaient français et offraient un fabuleux contraste. Ils se rendaient chez ma tante qui gérait deux boutiques accolées qui s'appelaient “ Les deux mondes ”, une sorte de bazar, bureau de tabac, où l'on fournissait tout et en particulier les insignes. Donc les signes, les signaux. Ces petits marins achetaient des galons et des cartes postales pour envoyer à leurs fiancées. Je pensais que, bien sûr, ces Deux mondes, avaient actuellement disparus. Or, cette année, j'ai appris qu'ils sont toujours là, et que c'était devenu une sorte de café en face du Théâtre municipal où Abdelkader Alloula et ses compagnons se réunissaient jusqu'à maintenant.
Les Juifs ont été jetés hors de la citoyenneté française par les décrets de Vichy. Mon père qui était médecin, et qui, en 1939, était médecin lieutenant sur le front, en 40, n'était plus français. Nous ne sommes pas allés à l'école, mais il ne me semble pas que nous l'ayons mal vécu, du point de vue de la dignité et de la joie de vivre. C'était un événement historique gravissime, mais nous n'étions pas menacés de mort, puisqu'il n'y avait pas de bateaux pour nous déporter. Moi, j'éprouvais depuis toujours une douleur terrible de la situation infâme faite aux Arabes, comme on disait. Nous étions déjà assez pauvres, et le fait de descendre encore plus me convenait tout à fait et ne me faisait pas souffrir. Mon père a vécu des événements violents comme on en vivait tout le temps dans le milieu médical où il y avait un racisme extraordinaire.
Le petit garçon cireur lui, est un Arabe. On ne voit pas qui d'autre aurait pu faire ce métier-là. En le rencontrant, j'ai senti venir le danger mais je ne pouvais rien dire, le silence s'imposait à moi. En Algérie, les yeux parlaient. J'ai vu de tout dans les yeux. J'ai vu de la tendresse, j'ai vu le meurtre très souvent, j'ai vu le viol. Là, j'ai tout de suite vu la haine, mais nous étions tout petits. Comment croire à cela ? Je ne pouvais pas me défendre. D'ailleurs je ne me suis jamais défendue. Se défendre, c'est avoir la bonne conscience pour soi. Or il y avait un sentiment d'inégalité. Si j'avais répondu, si je m'étais jetée sur lui, si j'avais fait un scandale, j'aurais renversé les choses de mon côté, et je n'aurais pas accepté cela. Ce petit garçon me cherchait, par la haine, il avait créé une forme de relation, de l'amour à l'envers.
“ Nous savions tout. J'aurais pu m'enfuir. Je ne pouvais pas m'enfuir. Si j'avais été innocente j'aurais crié, je me serais enfuie. J'aurais pu dénoncer sa haine, démasquer l'homme qui faisait semblant d'être un petit cireur de six ans. Je ne pouvais pas l'accuser sans m'accuser. D'où venait que je reconnaissais si bien le scintillement ? Je n'étais pas innocente. Je savais. Mais comment pouvais-je accuser un enfant de six ans d'avoir envie d'assassiner ? Je m'accusais d'abriter une pareille pensée. C'était le printemps rue Philippe ; et moi je frappais l'enfant à genoux sur le pavé. “ Pieds nus ”
Bidonville de la Femme sauvage à Alger






 e buée d'un bistrot, à vos murmures endormis au creux de vos draps complices des poussières de soleil passant par la fenêtre entrouverte...
e buée d'un bistrot, à vos murmures endormis au creux de vos draps complices des poussières de soleil passant par la fenêtre entrouverte...
 re illustrateur préféré que vous connaissez et on vous invite à faire un détour pour zyeuter ses images vous
en prendrez plein les mirettes ! Alors ne loupez pas cette occase d'être émerveillés c'est pas si courant...
re illustrateur préféré que vous connaissez et on vous invite à faire un détour pour zyeuter ses images vous
en prendrez plein les mirettes ! Alors ne loupez pas cette occase d'être émerveillés c'est pas si courant...




 n rassis avec un tas de personnages empaillés qu’on voit et qu’on revoit chaque année et qui ne nous ont jamais vues pourtant on est belles… il se distingue le bougre… D’un bout l’autre de la grande halle du marche des Blancs Manteaux si formidable de lumière pis qu’y faisait beau en plus et de bouquins vu qu’on y est plus de 700 revues là-dedans c’est pas rien… d’un bout l’autre ça ne causait que d’une chose… sûr que vous n’devinerez pas…
n rassis avec un tas de personnages empaillés qu’on voit et qu’on revoit chaque année et qui ne nous ont jamais vues pourtant on est belles… il se distingue le bougre… D’un bout l’autre de la grande halle du marche des Blancs Manteaux si formidable de lumière pis qu’y faisait beau en plus et de bouquins vu qu’on y est plus de 700 revues là-dedans c’est pas rien… d’un bout l’autre ça ne causait que d’une chose… sûr que vous n’devinerez pas…  tout prévu mais pas la fin du monde des riches… Ouais quoi ! quelle fin du monde n’import’ n’awoiq ! “ Dis pas du mal des riches !… ” comme le chante notre poteau Lavilliers ! “ On n’sait jamais… ”
tout prévu mais pas la fin du monde des riches… Ouais quoi ! quelle fin du monde n’import’ n’awoiq ! “ Dis pas du mal des riches !… ” comme le chante notre poteau Lavilliers ! “ On n’sait jamais… ”
 andises aussi ça va… Avec eux on n’chôme pas dans notre estomac et dans la relation plutôt chouette avec des gens qu’on n’connaît pas du tout et qui s’intéressent eux… enfin ça nous a changé des visiteurs de ce Salon qui eux tous ou presque s’occupaient d’une seule chose on dirait… ouais le fric faut bien l’dire… drôle de pays ici où on a jamais été aussi nombreux à inventer des créations dans tous les sens et où y’a personne qui s’en soucie…
andises aussi ça va… Avec eux on n’chôme pas dans notre estomac et dans la relation plutôt chouette avec des gens qu’on n’connaît pas du tout et qui s’intéressent eux… enfin ça nous a changé des visiteurs de ce Salon qui eux tous ou presque s’occupaient d’une seule chose on dirait… ouais le fric faut bien l’dire… drôle de pays ici où on a jamais été aussi nombreux à inventer des créations dans tous les sens et où y’a personne qui s’en soucie… 
 our la banlieue Nord de Marseille où elle bosse comme prof dans un lycée et puis Marie est repartie pour Vallauris retrouver les gamins et les gamines de la cité de la Zaïne pas loin du Moulin des Deux Rives où a lieu tous les étés le Salon des artistes de la Méditerranée… et moi je suis rentrée à Epinay dimanche soir dans notre cité d’Orgemont retrouver l’ami Louis et rêver à d’autres aventures pas ordinaires…
our la banlieue Nord de Marseille où elle bosse comme prof dans un lycée et puis Marie est repartie pour Vallauris retrouver les gamins et les gamines de la cité de la Zaïne pas loin du Moulin des Deux Rives où a lieu tous les étés le Salon des artistes de la Méditerranée… et moi je suis rentrée à Epinay dimanche soir dans notre cité d’Orgemont retrouver l’ami Louis et rêver à d’autres aventures pas ordinaires…
 t ouf… on n’pourrait pas les compter si on savait sur tous nos doigts d’étoiles de mer !…
t ouf… on n’pourrait pas les compter si on savait sur tous nos doigts d’étoiles de mer !…
 rents mais semblables comme étranges mais familiers comme venant d’ailleurs mais si proches est tout ce que nous avons à opposer aux maîtres d’un monde déjà mort et à ceux qui les servent…
rents mais semblables comme étranges mais familiers comme venant d’ailleurs mais si proches est tout ce que nous avons à opposer aux maîtres d’un monde déjà mort et à ceux qui les servent…
 g des rues étrangères à l'heure du crépuscule des toiles où rayonnaient des sexes de femmes telles des grenades et des carnets inachevés ?
g des rues étrangères à l'heure du crépuscule des toiles où rayonnaient des sexes de femmes telles des grenades et des carnets inachevés ?







 orsqu'on commençait à être aussi serrés les uns contre les autres que dans l'autobus qui descendait la rue de l'Ouest et que je n'empruntais pas. Mentir au garçon qui apportait machinalement une assiette de petites olives vertes dans lesquelles je croquais joyeusement en les saisissant avec mes doigts.
orsqu'on commençait à être aussi serrés les uns contre les autres que dans l'autobus qui descendait la rue de l'Ouest et que je n'empruntais pas. Mentir au garçon qui apportait machinalement une assiette de petites olives vertes dans lesquelles je croquais joyeusement en les saisissant avec mes doigts. ns le miroir géant s'étirant derrière vous une inscription venant à mon secours et n'en dénichant aucune je me suis résolue à proférer des paroles qui certainement allaient me rendre aussi ridicule que Pinocchio tentant de masquer ce nez qui n'arrêtait plus de grandir.
ns le miroir géant s'étirant derrière vous une inscription venant à mon secours et n'en dénichant aucune je me suis résolue à proférer des paroles qui certainement allaient me rendre aussi ridicule que Pinocchio tentant de masquer ce nez qui n'arrêtait plus de grandir.

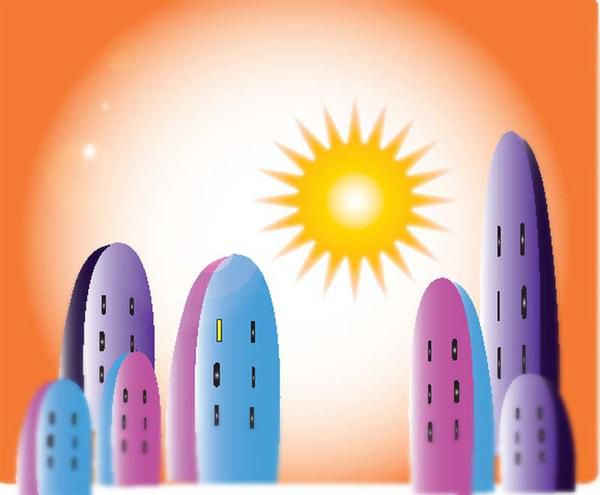
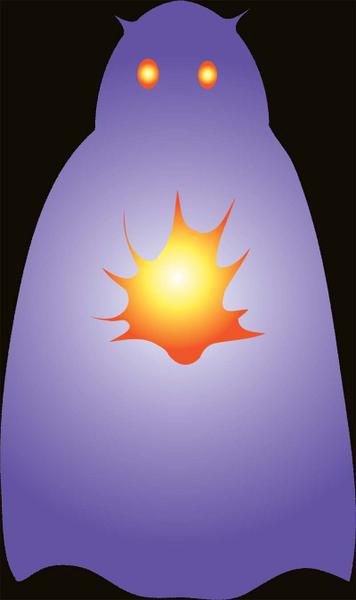 iver à notre quatrième une dame black avec deux loupiots qui marchaient tout juste… on se connaît pas mais on se sourit parce qu’aujourd’hui y a l’atmosphère conviviale magique partout…
iver à notre quatrième une dame black avec deux loupiots qui marchaient tout juste… on se connaît pas mais on se sourit parce qu’aujourd’hui y a l’atmosphère conviviale magique partout… j’ai songé au bonheur possible si c’était chaque jour comme ça la vie et je me suis dit que vraiment c’est ici dans notre cité parmi les gens que j’ai envie d’être longtemps toujours… Là c’est mon royaume et là je suis chez moi… Bonne fête à toutes et à tous !
j’ai songé au bonheur possible si c’était chaque jour comme ça la vie et je me suis dit que vraiment c’est ici dans notre cité parmi les gens que j’ai envie d’être longtemps toujours… Là c’est mon royaume et là je suis chez moi… Bonne fête à toutes et à tous !